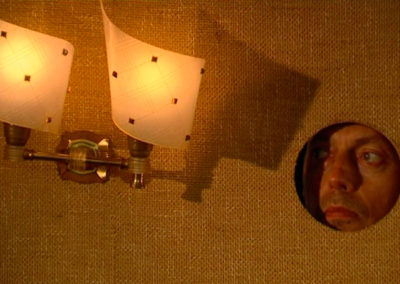Bienvenue à Bataville
“ À travers l’histoire des chaussures Bata, François Caillat traite d’une des dernières grandes utopies patronales du 20e siècle – celle de l’industriel Tomas Bata – et de ses dérives paternalistes.
Avec sa bande-son décalée (signée Pascal Comelade) et sa mise en scène proche d’une comédie musicale, Bienvenue à Bataville se présente comme un documentaire atypique, quelque part entre Ken Loach, Vicente Minelli et Jacques Tati. ”
Evocation insolite et stylisée d’une utopie patronale (Le Monde)
Un univers concentrationnaire dont les barreaux seraient peints en bleu ciel (L’Humanité)
Un coup de maître, un bijou (Liaisons sociales)
Le film qu’on attendait sur la fin du travail (Libération)
Un documentaire comme on n’a pas l’habitude d’en voir (Zerodeconduite)
Synopsis
En Lorraine, dans un coin perdu de la Moselle, une expérience économique et sociale inédite voit le jour à partir de 1932. Tomas Bata, l’homme qui veut « chausser l’humanité », décide de créer un laboratoire de la modernité. Son projet global s’appelle “Bataville” : une usine de chaussures, une cité modèle, une communauté de vie.
Le film remet en scène cette utopie patronale et raconte les dérives du paternalisme batavillois. Une fable burlesque sur le bonheur obligatoire, où les anciens ouvriers jouent leur propre rôle.
………………………………………
.
PRESENTATION DU FILM
En 1931, la famille Bata implante au sud de la Moselle, en pleine campagne, une usine de chaussures ultra-moderne. Autour de l’entreprise, elle crée Bataville, cité modèle pour travailleurs modèles. Sous l’œil d’un patron omniprésent, trois générations vont vivre et travailler dans cet univers clos.
François Caillat propose une visite de cette utopie patronale, sous la conduite fictionnelle de Tomas Bata, le père fondateur, et avec le concours des anciennes ouvrières qui jouent leur propre rôle.
Documentaire tourné comme une fiction, fable burlesque sur le bonheur obligatoire, le film montre l’usine et la cité dans en pleine gloire, telles qu’elles se présentaient dans les décennies prospères de l’après-guerre. Ou plutôt, telles que le patron voulait les voir.
Les témoins de cette histoire, trop merveilleuse pour être honnête, défilent devant nous à la manière d’une parade de cirque. Les ouvrières, recrutées très jeunes, soumises à des cadences éprouvantes et payées à la tâche, travaillaient très dur mais, précisent-elles, avec grand plaisir. Même tonalité nostalgique chez les autres « anciens », qui décrivent un monde juste et tranquille où les efforts étaient récompensés. L’ancien chef du personnel, clé de voûte de cette gestion paternaliste, raconte comment il « huilait » les rapports sociaux – fêtes, fanfares, compétitions sportives – et pourchassait les « mauvais esprits »…
Reste au spectateur à tirer les leçons de cette fable grinçante sur un bonheur factice et mortifère.
Bande-annonce et extrait du film
Fiche technique
Titre original : « BIENVENUE À BATAVILLE »
Titre anglais : « Welcome to Bataville »
90’, couleur, stéréo, 2007, France
Scénario et réalisation : François Caillat
Voix de Thomas Bata
Version française : dite par Jean-Marie Galey
Version anglaise : dite par Michaël Lonsdale
Musique : Pascal Comelade
Musique pour chœurs et arrangements : Jean-Christophe Marti
Image : Jacques Besse
Son : Stephan Bauer, Jean-Jacques Faure, Gilles Guigue, Myriam René
Montage : Sophie Brunet, assistée de Manuel Manzano
Mixage : Philippe Grivel
Conseillère artistique : Silvia Radelli
Conseiller historique : Alain Gatti
Format de tournage :
Beta num et super 8
16/9
Co-production :
Unlimited (Philippe Avril)
Les Films Hatari (Michel Klein)
Ina (Gérald Collas)
Avec la participation de :
Centre National de la Cinématographie, Ministère de la Culture et de la Communication, Programme MEDIA, Media Plus, Direction de l’Architecture et du Patrimoine, Région Lorraine, Région Alsace, Studio Orlando, CUS Communauté urbaine de Strasboirg, DRAC Lorraine
ISAN : 0000-0001-8D3D-0000-7-0000-0000-G
Visa d’exploitation cinématographique : 109.946 (2007)
Première sortie en salle : 2007
Entretiens sur l’utopie
Une utopie à Bataville
mené par Anne Brunswic, pour la revue “Images de la culture” (CNC).
Images de la Culture : Ce qui frappe dans Bienvenue à Bataville, c’est un travail très élaboré de dé-réalisation du matériau documentaire. Pourquoi ce parti-pris ?
François Caillat : J’ai voulu décrire un monde que je considère comme très artificiel, un monde de l’utopie, de l’autarcie. C’est ce monde que concevait Tomas Bata : un huis clos où la vie sociale serait protégée de toutes les contaminations possibles, un univers sans contradictions. Il pensait que les gens pouvaient vivre ensemble en parfaite harmonie, dans une bulle idéale où il n’y aurait plus de dangers intérieurs ni extérieurs.
J’ai cherché une mise en scène qui rende compte de cette artificialité. Les personnages ne sont pas déréalisés – ce sont des personnes qui existent vraiment et qui ont travaillé à Bataville – mais l’univers où ils vivent est volontairement décrit comme factice, faux.
IDC : Ceux qui vivaient là ne voyaient pas cet univers comme faux.
François Caillat : Par définition, quand on vit dans un monde autarcique, on n’en sort pas. On n’a donc pas de point de vue extérieur qui permette de voir à quel point ce monde est une bulle. Les Batavillois avaient peut-être conscience d’un monde clos, mais ils ne mesuraient certainement pas que leur existence quotidienne ne ressemblait à rien d’autre alentour. C’est comme s’ils avaient vécu sur une autre planète durant plusieurs décennies, entre les années 1930 et les années 1970. Par exemple, ils n’ont pas été affectés par les événements politico-sociaux de 36 ou de 68, ni par aucune contradiction du monde du travail. Le système faisait tout pour exclure de telles contradictions, par la persuasion et aussi par la force : les syndicats étaient empêchés de s’installer et les grèves impossibles. D’ailleurs, les salariés ont fini par intérioriser ce sentiment et ils ont souvent agi de concert avec la direction de l’entreprise pour que les contradictions n’arrivent pas jusqu’à eux. Ainsi, en 1968, quand des syndicalistes de la région se sont présentés à l’usine pour inciter à la grève, le personnel les a chassés à coup de lances à incendie !
Bataville, c’était un monde trop parfait pour être vrai. D’où ce sentiment d’artificialité que j’ai essayé de rendre dans la mise en scène.
IDC : En termes de prises de vues, de lumières ?
François Caillat : Le site de Bataville – l’usine et la cité alentour – existe encore aujourd’hui, mais j’ai tourné comme s’il avait été inventé, comme si c’était un décor de studio de cinéma. Pour autant, ce n’est pas un film de reconstitution et les Batavillois ne sont pas traité comme des comédiens. Je ne leur ai pas imposé de texte, je n’ai pas soufflé leurs réponses. Mais, dans la manière de filmer, j’ai essayé de donner une impression de faux – à l’aide d’un ensemble de paramètres techniques. Par exemple, les couleurs ont été travaillées dans un registre un peu cru, un peu saturé. Les briques des bâtiments sont tellement rouges qu’elles paraissent peintes d’hier. Les verts sont si verts que les pelouses semblent sorties d’un catalogue publicitaire. Tout est un peu luisant, bien astiqué, trop propre. Ainsi la cité et l’usine sonnent faux, et même la nature est coupée de la vie, comme reconstituée sous une bulle.
Avec le chef-opérateur, Jacques Besse, nous nous sommes inspirés de la peinture hyperréaliste américaine. Ces peintres, par exemple Richard Estes, travaillaient à partir de photographies et recherchaient un rendu parfaitement lisse. Nous avons voulu, comme eux, montrer un monde sans profondeur : un monde de la surface, de l’apparence, à la mesure du caractère factice de Bataville . C’est aussi pourquoi nous avons choisi de tourner en numérique plutôt qu’en argentique. Nous avions le choix. Mais le numérique permettait un rendu plus froid, presque glacé, quasi clinique. Ce choix est pour moi assez paradoxal : pour la télévision (Arte), j’ai fait plusieurs longs-métrages que j’ai tournés sur support argentique (super 16) parce que je cherchais un rendu romanesque ; avec Bienvenue à Bataville, destiné aux salles, j’ai pris le parti inverse et j’ai tourné en numérique. En fait, dans mon esprit, les choix technique et artistique font corps. C’est une même histoire.
IDC : Ce qui contribue à l’étrangeté c’est aussi le découpage des lieux. On n’entre pas dans Bataville, on s’y trouve plongé sans transition.
François Caillat : Tomas Bata, le fondateur de cette utopie, nous parle depuis l’au-delà. Il nous présente son petit monde, il fait le deus ex machina en reconstituant devant nous l’œuvre dont il est si fier. Mais il n’éprouve pas le besoin d’une narration trop réaliste. Il présente Bataville dans l’ordre un peu ludique de ses idées. Ou, si l’on veut, comme un bateleur dans un cirque, introduisant des numéros successifs dont l’ensemble fera fantaisie. Beaucoup d’éléments du film sont travaillés dans cette esthétique du cirque. Par exemple, il y a une fanfare (des musiciens issus de l’ancienne Harmonie de Bataville) qui tient dans le film le rôle d’un orchestre de cirque : elle scande le passage d’un numéro à l’autre et dynamise les transition ; il y a des personnages emblématiques, figures obligées du système (« La Piqueuse », « Le Footballeur »), qui sont présentés les uns après les autres dans une galerie de portraits tenue de main de maître par Bata. Le film ne propose pas une narration traditionnelle, comme on l’attend parfois dans le documentaire, avec une chronologie ou un suivi logique qui nous mènerait de A à Z. Ici, le dispositif est plutôt circulaire, redondant, à la manière d’une bulle tautologique. A vrai dire, nous sommes en présence d’une narration quasi autiste. Le film obéit à une voix off directive, à un discours monomaniaque, et son déroulement suit les méandres de la pensée du créateur/scénariste Bata. On ne s’étonnera donc pas que cette narration soit régulièrement dévoyée, obstruée – en somme, manipulée – par Tomas Bata qui se permet toutes les ellipses et zigzags possibles. Mais le discours du maître n’a pas à se justifier.
IDC : La lumière, le cadre et le son ont aussi été travaillés dans cet esprit.
François Caillat : Le film procède beaucoup par « pointage » : le démiurge Bata déploie devant nous le catalogue de sa création et choisit de nous montrer ce qu’il veut, comme il veut. On pourrait dire « comme il l’entend », car on retrouve ici une manière de faire qui avait été brillamment élaborée par Tati au niveau du son. Cela consiste par exemple en ceci : dans une scène sonore (paroles, bruits, etc.), on ne cherche pas à transcrire exhaustivement la réalité, mais juste à en extraire et « pointer » des sons privilégiés, ceux qu’on veut signaler au détriment des autres. Dans Bataville, il y a ainsi une scène avec un couple qui parle à haute voix et s’embrasse : on n’entend pas ce qui se dit, mais seulement le bruit doux du baiser. Ce traitement sonore vise à signifier un bonheur un peu outré, artificiel – en illustration du précepte de Bata : « Un mari agréable, une épouse discrète ».
On trouve souvent ce procédé indiciel chez Tati, dans une « mise en son » qui est une manière de déréaliser les scènes en leur faisant dire que ce qu’on a envie de dire. C’est autoritaire et en même temps très ludique. Cela fonctionne comme un clin d’œil adressé au spectateur.
IDC : Dans les interviews, les ouvrières évoquent la dureté des conditions de travail, mais elles expriment surtout leur adhésion à l’entreprise Bata.
François Caillat : C’est un film sur ce que La Boétie appelle la « servitude volontaire ». Elle comporte nécessairement deux termes, la servitude et le volontariat, une acceptation de son plein gré de conditions qui peuvent être très difficiles. On pourrait aussi appeler cela « aliénation », mais l’aliénation suppose une part d’inconscient. La question peut se poser, cette servitude volontaire est-elle totalement consciente ? J’hésite car les gens sont assez conscients que les conditions de bonheur auxquelles ils adhéraient se payaient très cher. Jusqu’à quel point ils se fermaient les yeux sur cette contradiction ? Ça dépend des individus. Mais on trouve toujours les deux termes, l’adhésion à un système qui continue à vous exploiter. Il y a par exemple cette ouvrière qui, dans l’interview, dit à la fois « c’était formidable » et « durant les six premiers mois, j’ai tout le temps pleuré ». On retrouve souvent cela dans le film, les gens énoncent des choses antinomiques, leur discours semble contradictoire. Comme cette femme qui raconte : « c’était sensationnel d’habiter à Bataville, ces petites maisons très proches où régnait entre voisins une convivialité exceptionnelle » ; puis, au détour d’une petite phrase, elle révèle que pour avoir la maison, il fallait la signature du contremaître, elle était soumise au bon vouloir de l’employeur.
DC : Ce qui brouille les repères documentaires, c’est aussi que le film donne très peu de repères chronologiques.
François Caillat : Il s’agit d’une utopie, au sens de Thomas Moore, c’est à dire une île, un lieu de nulle part, qui est aussi le lieu du bonheur. Ce n’est donc pas la chronique d’une cité avec un début et une fin qui ressembleraient aux histoires humaines normales. Si c’est le meilleur des mondes, inutile de le situer ni de le dater. Je n’ai pas fait un documentaire didactique, la chronique d’une cité mosellane. Pour autant, il y a tout de même une histoire. Bataville a été construit en 1932 et l’usine a fermé en 2001. Entre ces deux dates, trois générations d’ouvriers se sont succédées. L’âge d’or, c’est la deuxième génération qui correspond aux « Trente Glorieuses », les années 1950-60. C’est à ces décennies que le film s’intéresse, et ce choix est signalé par des petits indices : on voit passer une 2CV, une DS, on écoute une femme vêtue d’un chemisier Vichy, etc. Mais je ne voulais pas pour autant faire une reconstitution. J’ai pris ces années-là parce que ce sont celles où le système était à son apogée.
IDC : Une époque de prospérité où le patronat pouvait tenir ses promesses ?
François Caillat : La proposition de Bata était simple, claire : en échange d’une grande exploitation de votre force de travail, je vais vous offrir des conditions de bonheur optimal. Et c’est ce qui se passait. Certes, pour la première génération, celles des pionniers des années 1930, avec les conditions très dures de l’avant-guerre, ce n’était pas encore le cas. Ni à l’autre bout, dans les années 1970-80, quand l’entreprise se délitait et que les promesses de bonheur devenaient inaudibles. Mais entre les deux, à la grande époque des décennies 1950-60, il y a eu jusqu’à 3.000 ouvriers et le système fonctionnait au mieux, tant à l’usine que dans la cité. L’idéologie Bara était alors très performante.
Le drame, dans cette affaire, c’est que l’entreprise Bata s’était toujours présentée comme un projet messianique qui ne visait pas simplement à produire des chaussures, mais qui voulait « chausser l’humanité » (mot d’ordre officiel) dans des conditions de bonheur absolu et au sein d’une collectivité de travail très soudée. Et finalement l’usine a fermé comme n’importe quelle autre.
IDC : On peut reprocher au film d’enfermer les interviewés dans un corset et de les instrumentaliser.
François Caillat : Mon parti-pris n’est pas sans risque. J’ai choisi de fabriquer un film symétrique de ce qu’il dénonce. Je présente un système autarcique géré par un autocrate et, plutôt que de faire un film de dénonciation extérieure, j’ai pensé que le meilleur moyen était que le système se dénonce lui-même. Donc, j’ai confié les rênes à son fondateur et maître Tomas Bata. Le spectateur découvre ainsi que, dans l’énoncé même du bonheur, il y a tous les germes de sa destruction. Depuis l’au-delà, Tomas Bata nous parle et nous vante son petit monde et, naturellement, il enferme les gens dans sa bulle. Sinon totalitaire – il n’y a eu ni camp ni mort d’homme -, du moins totalisante en ce sens que rien d’oppositionnel n’était supporté. A partir du moment où je confie les rênes du film à Tomas Bata, il va en faire un usage « bataïque » : un peu dictatorial. N’oublions pas qu’il est patron de droit divin. Ainsi, de même que les opposants étaient exclus du système, les opposants dans le film – ceux qui viennent exprimer leurs critiques lorsqu’ils sont interviewés – sont exclus du montage. Leur parole est rapidement coupée, ou brouillée par des artifices sonores. Mais on entend toujours le début de leur réponse. L’expulsion de la parole déviante est explicite. Ils sont là et la censure est exhibée. Dès qu’arrivent les mots fatals « profit » ou « paternalisme », immédiatement les gens sont éjectés. En fait, je mets en scène la manière dont le système évince ses opposants.
Il aurait été très facile de dénoncer de l’extérieur, de crier haro sur le patron paternaliste. Je trouve que c’est plus intéressant d’analyser le système de l’intérieur, de le laisser formuler lui-même ses propres contradictions. J’ai essayé de montrer un système qui énonce sa faillite tout en croyant vanter sa réussite. Avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur parfois ! Ainsi, dans les propos du chef du personnel : il a l’air très convaincu, il est même parfois convaincant tant ses mimiques appuient ses dires, et le voilà soudain jovial pour nous souffler, comme une confidence faite à un ami : « Le personnel, ce qu’il veut, c’est être dirigé ».
Quand cette phrase est dite, tout est dit. Inutile d’ajouter un commentaire moralisateur invoquant la honte ou la révolte.
IDC : Une dernière question : comment se situe Bienvenue à Bataville dans votre filmographie où apparaît souvent la Moselle et le monde industriel ?
François Caillat : J’ai tourné trois films dans ce même périmètre lorrain : La Quatrième génération, Trois soldats allemands et Bienvenue à Bataville. C’est un lieu où j’ai passé mon enfance, avec lequel j’ai des liens affectifs. Dans le travail d’un cinéaste, il y a beaucoup de choses qui sont de l’ordre du désir, de l’intuition, des sensations d’enfance visuelles, olfactives. Un film, ce n’est pas l’illustration d’une thèse ! Dans La Quatrième génération, je m’étais intéressé à l’histoire de ma famille, avec son versant économique qui était l’entreprise de mes aïeux. En trois générations – comme à Bataville mais à bien moindre échelle – ils avaient monté une affaire, l’avaient développée, et finalement liquidée. J’avais envie de traiter d’une histoire économique dans cette partie de la Lorraine, mais je pensais que la scierie familiale était un cadre un peu étroit. Aussi, j’ai été content de découvrir l’existence de Bataville qui se trouve juste à côté.
Outre mon attachement affectif à la région, outre mon désir de travailler à travers plusieurs générations sur un monde industriel, il y a une troisième raison qui se retrouve dans tous les films que j’ai faits depuis une dizaine d’années, ceux que j’ai cités et plus encore L’Affaire Valérie : je m’intéresse aux représentations du passé, à la manière dont il vient jusqu’à nous, à travers les traces, les souvenirs, les paroles. A l’opposé d’un cinéma de reconstitution, j’essaie de voir comment le passé affleure jusqu’à nous.
IDC : Plus du côté de la mémoire que de l’histoire ?
François Caillat : Oui. Et même de la mémoire absente. Généralement, je suis d’autant plus intéressé par le passé qu’il en reste peu de traces – comme dans L’Affaire Valérie ou Trois Soldats allemands où j’ai refabriqué du passé quasiment à partir de rien : des décors vides, des énigmes irrésolues, des visages manquants, des photos disparues. C’est dans tous ces « rien » que je cherche les signes du passé, sa venue jusqu’à nous.
Avec Bataville, j’aurais pu adopter une esthétique de la disparition – filmer les bâtiments vides de l’usine, me mettre en quête des disparus, etc. – mais c’est un cinéma qu’on a déjà beaucoup vu dans le genre documentaire social des dernières décennies. Je ne voulais pas refaire l’ènième plongée dans les décombres d’un monde englouti. Alors j’ai plutôt tenté d’imaginer comment c’était quand cela fonctionnait bien. Tandis que, dans mes précédents films, j’avais travaillé sur le vide et l’absence de traces matérielles du passé, dans Bienvenue à Bataville j’ai plutôt travaillé sur le plein. Cela peut surprendre, mais c’est pourtant le même projet : un travail sur le lien entre passé et présent.
Je ne suis pas dans le cinéma direct, ni dans le cinéma vérité. J’aime en regarder mais, comme cinéaste, je ne suis pas dans un cinéma du présent. Je ne suis même pas sûr d’être dans un cinéma du réel. Je filme plutôt « sous » le réel. Certes c’est bien du cinéma documentaire, en ce sens que je filme ce qui est. Mais ce n’est pas la vision immédiate qui m’intéresse. J’essaie de voir ce qu’il y a dessous, comment le passé est venu jusqu’à nous, comment les traces des générations antérieures se manifestent devant nous. C’est un cinéma documentaire de la trace, ou de l’absence, un cinéma un peu fantomatique. Ni tout à fait l’Histoire, ni tout à fait la mémoire, plutôt entre les deux – un jeu entre l’absence et la présence. C’est exactement ce que j’ai voulu faire avec Bienvenue à Bataville. J’ai essayé de faire revenir le fantôme de ce que fut Bataville, et c’est ce que je recherche au fond dans chaque film.
Entretien réalisé par Anne Brunswic, paru dans la revue « Images de la Culture » (CNC), n° 24, été 2009.
À quel prix doit-on payer l'utopie ?
mené par Jean Roy, pour le journal “L’’Humanité”.
À travers l’histoire des chaussures Bata et de la méconnue Bataville, le réalisateur François Caillat s’attache à un formidable exemple de capitalisme familial paternaliste.
Le documentaire, quand il est réussi, présente cette vertu de toujours donner envie d’y voir plus loin. D’où l’impérieuse nécessité de rencontrer François Caillat pour lui parler de Bataville. Chose faite il y a quelques jours à Paris pour notre plus grand bonheur et, on l’espère, celui du lecteur, dans l’unique regret de n’avoir pu rendre compte intégralement d’une discussion aussi riche que passionnante.
Jean Roy : Pourquoi Bataville ?
François Caillat : Je voulais traiter d’un sujet lié à l’économie en Lorraine. J’avais déjà fait deux films dans cette région dont je suis originaire. Je ne connaissais pas très bien l’histoire au départ. Il y avait là une ampleur que je n’imaginais pas, comme je n’imaginais pas son caractère exemplaire. On peut parler d’autre chose que de la petite chose dont on parle. Ici, cela parle de la Lorraine mais on n’y reste pas, sans pour autant la quitter. Au départ, je n’avais pas une intention affirmée avec une thèse qu’il suffisait d’illustrer mais une intuition de désir, sans avoir la masse des connaissances et de leurs développements. Par ailleurs, tout le monde connaît les chaussures Bata mais pas Bataville, d’où l’intérêt, même s’il existe d’autres cas de capitalisme familial, Michelin, les aciéries De Wendel aussi en Lorraine, ou Boussac.
Quel est ce lieu ?
François Caillat : C’est un endroit qui réunit de manière parfaite tous les ingrédients de l’histoire, un concept assez abouti. Je me suis concentré sur la période des années cinquante et soixante, qui est l’apogée du système, de l’utopie patronale et aussi bien sûr de l’exploitation. Ensuite, cela se délite. C’est un lieu où il y avait beaucoup de distractions culturelles et de possibilités de faire du sport. Il y avait l’harmonie musicale, le bal, sachant que la culture formatrice était dans les écoles de formation. J’ai découvert l’existence d’un historien qui a écrit une monographie de sept cents pages sur le sujet. Aujourd’hui, c’est un endroit de perdition totale sur lequel on ne tombe pas spontanément alors que l’aventure de Bataville commence en 1931 et qu’elle avait même été précédée par son équivalent à Zlin, en République tchèque, d’où provenait Bata.
Idéologiquement, c’est du pain bénit. Le système est complètement verrouillé et attractif, d’où le sentiment des gens qui ont vécu là-bas. Mais quand les choses ont commencé à se déliter, c’est très vite devenu une entreprise comme une autre puis une faillite comme une autre. La blessure narcissique a été totale. On avait tenu à ces gens un discours tel qu’il n’a même pas été remis en question mais abandonné du jour au lendemain. Et, du moment où c’est devenu une entreprise comme une autre, les frontalités sociales sont apparues comme ailleurs. Bataville est un film sur l’aliénation.
Et pratiquement…
François Caillat : Bataville, c’est deux mille cinq cents employés, ouvriers et cadres dans une même entreprise. Une famille sur trois habitait à Bataville, qui n’avait pas été conçu pour loger tout le monde. Le contremaître décidait qui pouvait y habiter, donc la partie méritante. Pour les autres, ils venaient de partout, même d’Allemagne, car les salaires étaient supérieurs d’un tiers à ceux de la région. Il y avait un système de ramassage avec une trentaine de cars. Cela n’empêche pas qu’au départ l’endroit est assez peu connu. Nous sommes dans la Moselle agricole, sans aucune tradition ouvrière et syndicale. C’est un lieu très arriéré dans les années trente, un endroit où on peut façonner un homme nouveau, d’où l’idée de le prendre aussi vierge que possible. À cette époque, les Bata ont eu du mal à s’implanter et il y a même eu une loi anti-Bata. Après, ils sont devenus indélogeables. Alors qu’ils n’avaient jamais respecté la législation du travail, et ce en période de plein-emploi, ils ont été très soutenus. Pierre Messmer était là en voisin comme maire de Sarrebourg et, comme on le voit dans le film, à la moindre cérémonie il y avait le préfet.
Il y avait une formation maison à la fabrication de la chaussure maison qui empêchait de trouver du travail ailleurs, et les syndicats étaient refusés. Songez qu’à Bataville il n’y a pas eu de grèves en 1936 et pratiquement pas en 1968. Puis, en 1985, est arrivée la concurrence italienne et seulement en 1990 les grandes luttes syndicales alors que l’entreprise périclite, avec une violence extrême qui est un peu le meurtre du père tant les ouvriers se sont sentis complètement trahis. D’où un film difficile à faire puisqu’il fallait mettre en avant deux choses totalement antagonistes, se faire exploiter et être heureux dans le système dans une sorte de donnant-donnant pas vécu explicitement. C’est une tradition dans le documentaire de s’intéresser au monde de l’entreprise et du travail, de donner une parole à ceux qui en sont privés. Là repose l’espèce d’humanisme des documentaristes. Donc les films travaillent la question de l’exploitation, mais très peu la question de l’aliénation. Or, ici, songez que le 1er Mai est la fête de l’usine ! Je trouve plus difficile de parler de cela.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
François Caillat : C’est un site industriel à étages, vide, car actuellement on préfère le plain-pied. Les bâtiments sont très beaux. Quand à la cité, elle vit cahin-caha et tout le reste a disparu. Des moutons paissent sur le terrain de foot et la piscine a été remblayée l’an dernier. Il y a eu une petite tentative de reprise avec trois cents ouvriers mais elle n’a duré que trois ans. La liquidation a été totalement organisée, dans un système de chute progressif, ce qui n’empêche pas que Bata se porte plutôt bien aujourd’hui. C’est un groupe de droit canadien qui fait dans la finance et délocalise en Afrique et en Asie. Sur les trois générations, on a à la tête de la première un cordonnier qui a une vision et fabrique un empire. Le fils fait du commerce et le petit-fils fait de la finance. Je ne raconte pas l’histoire sur soixante-dix ans mais elle est passionnante.
Ce qui m’intéresse est comment un projet devient utopie, qui, pour se réaliser, aboutit à devenir totalement coercitif. Je vois qu’on a encore besoin d’utopie mais à quel prix doit-on payer l’utopie ? On a proposé à ces gens bien plus que du travail, une participation à une mission collective civilisatrice. Le frère du premier Bata a postulé au prix Nobel. Il voulait chausser l’humanité entière. Dans les années trente, cela veut dire quelque chose. Il a été le premier à amener le caoutchouc en Lorraine, la faisant passer du sabot au caoutchouc, et c’est pour soulager l’humanité qu’il a fait les ponchos en caoutchouc pendant la guerre. Le Corbusier a voulu construire Bataville, y est allé sur ses deniers et a produit un projet avec barres et autoroute. Cela n’a pas marché parce que Bata préférait le concept de cité-jardin et sans doute avait-il raison. Si Bata périclite dans les années quatre-vingt, c’est parce que la clientèle mal chaussée n’existe plus et, quand il part en Afrique, c’est parce qu’il y a là-bas une clientèle pieds nus, pas juste pour délocaliser. Soit donc ce qu’on appelle le « bataïsme », un mélange de messianisme et d’un système très autoritaire avec, aussi, beaucoup de manipulation.
Pourquoi avoir qualifié le film de « fable documentaire » ?
François Caillat : C’est un film particulier dont le traitement manie plusieurs registres. Dans le film, tout est vrai sauf la voix de Bata, mais ce qu’il dit est pris dans ses discours. L’approche classique est renversée. C’est un patron qui parle. Le système se décrivant lui-même s’écroule de lui-même. Voir ce que dit le chef du personnel, qui a aujourd’hui quatre-vingt-quatorze ans et est entré chez Bata en 1933 comme aide-comptable : « Ce que veulent les gens, c’est être dirigés. » C’est formidable parce qu’il énonce avec beaucoup de clarté toute la marche du système. J’ai un certain respect pour lui car il a bien vu ce que je faisais et il a joué le jeu, il s’est exposé. C’est l’histoire d’une balle, d’un système fermé pseudo-parfait sans contradiction. L’harmonie gère les rapports entre les êtres, ce qui vient du socialisme utopique du dix-neuvième siècle avec Fourier et Saint-Simon, mais avec l’ajout du taylorisme, la division du travail, le capitalisme fordien. Bata est un antimarxiste convaincu qui n’est pas partisan de la confrontation comme moteur de l’histoire.
Entretien réalisé par Jean Roy, “L’Humanité”, mercredi 19 novembre 2008, n° 19942
Intentions de l’auteur
Pourquoi je suis venu à Bataville...
Depuis longtemps, lorsque je traversais cette bourgade de Moselle, je me demandais par quel hasard se trouvait construite là cette cité moderniste, style années 30, faite de jardinets coquets et pavillons en briques rouges, sans ressemblance aucune avec les villes ou villages lorrains avoisinants. Bataville, par son allure, semblait appartenir à un autre univers, comme une curiosité, une lubie d’architecte, une réalisation futuriste qui tranchait avec la Lorraine champêtre au style si reconnaissable.
De fait, je connaissais bien cette Lorraine mosellane pour y avoir déjà tourné deux films de long-métrage, diffusés sur Arte. La Quatrième génération (1996) racontait la saga de ma famille dans cette région, à travers une aventure à la fois personnelle (les trois générations de ma famille), économique (les forêts et scieries de mes aïeux, aujourd’hui disparues) et nationale (les incidences des annexions allemandes) ; Trois Soldats allemands (2001) reprenait certains éléments de cette histoire familiale pour évoquer, plus largement, le destin misérable et tragique des Mosellans contraints, comme les Alsaciens, de porter l’uniforme allemand durant les deux guerres mondiales.
Pour ces deux films, situés dans le même périmètre régional, j’avais fait de nombreux tournages dans les villages et bourgs, champs et forêts, et j’avais acquis une assez grande familiarité avec le décor. Or, parfois, durant mes repérages ou en allant d’un lieu de tournage à l’autre, il m’arrivait de traverser cette énigmatique bourgade de Bataville. D’où sortait cette cité moderne, construite en plein milieu des champs, à mi-chemin de villages d’antan aux architectures campagnardes ? Certes, je me doutais que l’appellation du lieu venait du nom du fabricant « Bata », et je me souvenais avoir porté moi-même des chaussures Bata quand j’étais petit. Je savais aussi que l’usine tournait encore, quoique’au ralenti, et je pouvais voir les travailleurs qui venaient ou repartaient du site. Mais je n’en savais pas vraiment plus. De fait, rien ne m’y menait quand je suivais l’histoire économique de ma famille, liée à l’industrie du bois, ni quand je m’intéressais aux problèmes d’identité créés ici par les guerres franco-allemandes.
Un jour, la curiosité l’a emporté…
J’ai découvert que la cité faisait partie d’une réalisation plus vaste. Que les maisons et les bâtiments de l’usine n’étaient que la partie visible d’un projet plus grandiose, conçu en 1930 comme un rêve patronal utopique. En me documentant sur ce projet, en découvrant son histoire durant soixante-dix ans, j’ai compris pourquoi la traversée de Bataville m’avait toujours tant étonné ; pourquoi cette bourgade ne ressemblait à rien dans la région, avec sa construction en cité-jardin et ses maisons aux toits plats ; pourquoi, en somme, Bataville était une sorte de concept importé de toutes pièces, une excroissance inexpliquée, une pure invention. Tout simplement parce que le projet du fondateur Tomas Bata consistait à créer un monde inédit et forger un homme nouveau, dans un décor qui ne s’y était alors jamais prêté.
Bata avait voulu que sa ville soit si nouvelle qu’elle ne ressemble à rien. Et c’est cette nouveauté, visible, palpable, qui m’a intrigué au point de vouloir en faire un film.
Par la suite, l’histoire de Bienvenue à Bataville m’a entraîné, presque malgré moi, là où je ne savais encore que j’irais : dans la description d’un système aliénant, dans un monde fait de récompenses et de coercitions, au cœur d’un dispositif paternaliste à l’excès.
François Caillat
Le spectacle d'une bulle
Dans Bienvenue à Bataville, j’ai voulu raconter l’histoire d’une bulle : un monde parfait, un système idéal, une utopie patronale dont l’âge d’or nous replonge dans les années 1950/60. Bataville est le nom donné à la cité créée par Tomas Bata, le célèbre industriel de la chaussure tchèque, arrivé en Lorraine avant-guerre. En s’installant dans un coin de Moselle où n’existaient jusqu’alors ni traditions industrielles ni culture syndicale, Tomas Bata a voulu forger de toutes pièces un site qui lui serait entièrement dévolu, loin des influences contraires à la mission qu’il se fixait.
De cette création ex nihilo est née l’idée d’une bulle harmonieuse, intégrant tous les ingrédients d’une “ vie Bata ” réussie. Ainsi Tomas Bata a-t-il disposé autour de son usine les différents modules de son projet : cité pour loger les ouvriers (bâtiments modernes et fonctionnels dans une architecture de cité-jardin), centres d’apprentissage (école et formation professionnelle), équipements sportifs de haut niveau (piscine et stade, avec performances en foot et basket de niveau national), lieux de divertissement et convivialité (cinéma, salle des fêtes avec orchestres prestigieux et fanfare locale), etc.
En intégrant tous ces services destinés à accompagner le Batavillois de sa naissance jusqu’à sa mort, Tomas Bata a organisé un système à la fois attractif et terriblement contraignant. Certes la conception du site visait au bonheur de tous, mais sa finalité ultime restait la fabrication de la chaussure Bata à meilleur prix. Dans ce monde trop parfait, toutes les critiques étaient écartées et les récalcitrants impitoyablement chassés. Le système, performant et rigide, a très bien fonctionné durant plus de soixante ans. Son apogée, coïncidant avec les Trente Glorieuses françaises, s’est située durant les deux décennies 1950 et 1960 évoquées dans le film. Bataville représentait alors un modèle inégalé de réussite industrielle (Bata était le premier fabriquant national de chaussures), de collectivité sociale (à travers les rites et usages de la vie batavilloise), et de culture idéologique maison, appuyée sur un corpus de textes et discours régulièrement remis à jour : le bataïsme.
Le film nous fait découvrir cette époque joyeuse, où chacun contribuait avec ardeur au bonheur de l’entreprise. On écoutera, sans doute avec quelque étonnement, cette ouvrière raconter sourire aux lèvres quel fut son plaisir à fabriquer onze millions de chaussures en quelques années sur sa machine bruyante ; on entendra le chef du personnel rappeler avec fierté comment “ ses ” employés venaient le trouver pour régler leurs problèmes domestiques, illustrant cette maxime fondatrice de l’entreprise : “ Le personnel, ce qu’il veut, c’est être dirigé ” ; on découvrira les témoignages et souvenirs de tous ceux-là qui ne regrettent rien…
Le film explore cette époque en pointant ses évidentes contradictions : comment pouvait-on être heureux dans un environnement quotidien si normé ? Comment conservait-on un espace de liberté personnelle dans ce monde totalement créé à l’image de son fondateur et maître Tomas Bata ? Comment pouvait-on vivre, des années durant, sous la coupe d’un tel paternaliste ? Voilà bien le paradoxe que ce film veut découvrir et mettre en scène : la soumission plus ou moins consentie, la “ servitude volontaire ” dont parlait autrefois E. de La Boëtie, l’aliénation où se conjuguent le bonheur et l’exploitation.
De cet exemple batavillois, le film espère faire un paradigme. D’autres exemples sont en effet nombreux, tout au long du XXème siècle, où une adhésion collective enthousiaste s’est mise au service de principes discutables. Les idéologies ne sont pas seules en cause. Il faut se demander comment des millions de gens ont pu participer, avec tant de ferveur et de conviction, à des systèmes qui finissaient par les broyer. Comment la volonté collective de partager des projets communs a pu se muer en entreprise totalitaire et destructrice.
Si l’aventure de Bataville ne s’est pas terminée en désastre national, la fermeture définitive du site en 2001 a plongé des milliers de familles dans la misère et le désarroi. Elle a signifié que les meilleures intentions patronales, mêmes lorsqu’elles sont mises en œuvre par des hommes de la trempe de Tomas Bata, finissent par buter sur l’injustice sociale. A Bataville, il ne suffisait pas de fabriquer des chaussures dans la joie quotidienne, il eût fallu aussi que le bonheur ne soit pas promu au bénéfice ultime du patron.
François Caillat
Le film vu par…
Le film vu par... Nicolas Philibert, cinéaste
NICOLAS PHILIBERT : APPROCHEZ, APPROCHEZ
Approchez, approchez ! Par ici Messieurs Dames… Bienvenue en Moselle ! Bienvenue à Bataville ! Venez voir ce qui reste de l’empire de Bata, le roi de la chaussure, le patron à la Papa ! Approchez, approchez ! Par ici Messieurs Dames… Venez voir comment on vivait chez Bata, l’homme qui voulait faire le bonheur des ouvriers, qui voulait rendre service à l’Humanité ! Approchez, approchez ! Bienvenue à Bataville : ses ateliers, ses ouvrières, son chef du personnel ! De l’ordre et du respect, le goût de l’effort et du rendement ! Deux mille paires de chaussures par jour ! Bravo Madame, bonheur et prospérité ! Parti de rien, Bata ! Oui, Monsieur ! Un bâtisseur, un philosophe, un inventeur ! La cité idéale ! Ah, la salle des fêtes ! La buvette ! La fanfare ! Ah, la piscine en plein air, le terrain de basket, le tennis, le foot… Une jeunesse forte et saine, des corps vigoureux ! Et aussi la coopérative, le cinéma, les premiers flirts, l’amour et un jour le mariage, oui Monsieur ! Une vie simple, toute tracée, bien droite. Les lotissements, la naissance des enfants, les balançoires, les bacs à sable. Bata a tout prévu. Le bonheur à portée de la main ! Les banquets, les discours, les remises de médailles… Allez, allez, dépêchez-vous, ça va commencer ! Vous aimez Jacques Tati ? Vous aimerez Bataville ! Venez voir le merveilleux film de François Caillat, venez voir le monde à travers les yeux de Bata.
Nicolas Philibert est cinéaste. Il a notamment réalisé « Etre et avoir », « Retour en Normandie », « La Maison de la radio », « La moindre des choses », « La ville Louvre »… et dernièrement : « Sur l’Adamant »
Le film vu par... Jean-Pierre Thorn, cinéaste.
JEAN-PIERRE THORN : UN FILM A L’HUMOUR RAVAGEUR
Bienvenue à la « capitale de la chaussure heureuse », au « petit Monaco » inventé par Thomas Bata où le mot « collaborateur » prenait tout son sens.
Un film décapant – à l’humour ravageur – qui transgresse allégrement les codes cinématographiques du documentaire et rejoint la comédie musicale (façon Broadway) ou l’ironie grinçante d’un Jacques Tati.
Au son des hymnes d’époque (à la gloire du patron) ou des rythmes jazzy des anges musiciens de l’harmonie d’entreprise (ça ne s’invente pas !), on déambule, en fascinants travellings, dans la « cité du bonheur » où s’épanouissait l’utopie d’un monde de collaborateurs régit par la seule méritocratie quand patrons et ouvriers « allaient au travail comme on va au bal » sur les valses délicieusement grinçantes du compositeur Pascal Comelade.
Une œuvre – incroyablement étonnante et détonante – à l’écriture d’une provocante modernité qui interroge nos fabriques d’utopies des « 30 glorieuses » quand le paternalisme d’une certaine culture d’entreprise rejoint l’incantation à la fortification de la race pour « prouver que la France n’est pas un pays de décadence » et qui, au final, ressemble étrangement aux paradis perdus des films de propagande staliniens.
Une interrogation, on ne peut plus d’actualité, sans jamais sombrer dans un quelconque mépris vis-à-vis de ses protagonistes: « Elles sont épatantes, vous ne trouvez pas, mes ouvrières ?! »
Jean-Pierre Thorn est cinéaste. Il a notamment réalisé « 93 : la Belle Rebelle », « On n’est pas des marques de vélo », « Faire kiffer les anges », « Le dos au mur », « Oser lutter, oser vaincre, Flins 1968 »…
Le film vu par... Isabelle Péhourticq, éditrice
Au commencement furent des pieds. Des pieds à chausser, des milliards de pieds à travers le monde. Alors, par le seul pouvoir de son Verbe, Tomas Bata, le Créateur, fit jaillir dans les années 30, en plein cœur de la campagne mosellane, une usine de chaussures des plus modernes et surtout, une ville entière pour y faire vivre ses ouvriers. Une cité plus radieuse que celle de Le Corbusier, plus pimpante et fonctionnelle que le familistère de Guise… Bref, une utopie réalisée. Une utopie ? Voire…
D’emblée, le réalisateur choisit, non sans perversité, d’imposer la voix off du démiurge ressuscité, de retour sur les lieux d’un paradis perdu aujourd’hui rendu à la nature. Cette voix off est l’élément majeur d’un dispositif singulier qui va mettre au jour les failles d’une organisation sociale aux rouages bien huilés. Trop bien huilés.
Plus mégalomane mort que vivant – il se prend pour Dieu -, Tomas Bata pilote le spectateur dans tous les lieux archétypaux de la mythologie batavillienne : l’usine, la salle des fêtes, la piscine… Mais le temps a fait son œuvre, et ces lieux ont disparu ou ont perdu de leur prestige. Qu’importe : la piscine désaffectée est suggérée par un plan du plongeoir, une serviette ; la salle des fêtes défraîchie par des couples de danseurs… Les maisons identiques sont balayées par un travelling interrompu de temps à autre pour permettre à Dieu/Bata de saluer ses employés, dont les gestes (tailler une haie, tondre le gazon) sont aussi apprêtés que le décor qui les entoure. Les sourires doivent être radieux, l’omniscient Monsieur Bata vous regarde.
Les témoins de l’Age d’Or – le chef du personnel, ex-sergent recruteur, les ouvrières, les sportifs du club de Bataville – sont filmés en plan fixe dans le décor symbolique de leur ancien lieu de travail, figés comme sur un portrait à l’ancienne. Tout droit sortie des premiers films parlants, une voix triomphante renforcée par des cartons écrits en pleins et en déliés introduits les anciens salariés l’un après l’autre. La hiérarchie est respectée : « le » chef du personnel, « l’ » entraîneur, pièces irremplaçables de l’encadrement, ont droit à l’article défini. Quant à l’ouvrière, pièce interchangeable de l’outil de production, elle n’est qu’« une » ouvrière. Dans cet au-delà muséifié, les rapports de classe se sont naturalisés.
À en croire Dieu, Bataville fut une cité de rêve : comment contester le bonheur lorsque le soleil brille, que les pelouses rutilent et que les hymnes à la gloire de Bata interprétés par la fanfare et la chorale retentissent à chaque séquence ? A contrario, en contrechamp, les images lugubres des marais d’aujourd’hui où, plan du site entre les mains, les anciens Batavillois errent désorientés…
Nulle voix discordante n’est tolérée. L’un des témoins a-t-il le culot d’évoquer les bénéfices qu’ont empochés les actionnaires ? Son propos est interrompu par Dieu lui-même. Des entretiens avec les ouvrières, le montage final conserve l’évocation de la dureté des tâches, mais insiste davantage sur le plaisir de travailler ensemble. Ces paroles réjouissent le Créateur, dont la vision de l’entreprise exige l’adhésion enthousiaste de tous. Qui oserait parler d’aliénation ?
Mais l’utopie a fait long feu. Avec le verbe de Bata, le « piège » du dispositif filmique se referme : les haut-parleurs de s’éteignent plus, mitraillant des sermons apologétiques sur les bienfaits du travail et du sport, ou des slogans aux relents totalitaires (« Ne soyons pas en verre, mais en acier ! »1).
Témoignages sous contrôles, films d’archives complaisants, reconstitutions de scènes idéalisées… Le malaise se dessine. La polychromie éclatante des images, les flonflons de la fanfare finissent par rendre insupportable le paternalisme Bata. On se croyait chez Jacques Demy, on se retrouve dans la série Le Prisonnier… Perdue au milieu des champs, Bataville est plus que jamais une ville-prison. Ses anciens habitants ne pourront s’en échapper que pendant le sommeil de Dieu, la nuit venue, un flambeau à la main.
1 Dans le film, les maximes et citations de Tomas Bata sont extraites de l’ouvrage « Chausser les hommes qui vont pieds nus, Bata-Hellocourt, 1931-2001 », Alain Gatti, Ed. Serpenoise.
Isabelle Péhourticq est éditrice responsable des documentaires et des livres-CD aux éditions Actes Sud Junior, et auteur de romans. Elle est aussi critique indépendante de cinéma : son texte est paru dans “Hors Champ”, le quotidien des Etats Généraux du film documentaire de Lussas.
Le film vu par... Anne-Laure Farges, rédactrice
ANNE-LAURE FARGES :
FRANCOIS CAILLAT FAIT REVIVRE LES FANTÔMES
François Caillat est un cinéaste rare, un documentariste de l’absence et de l’oubli, ou plutôt de l’empreinte que laissent l’absence et l’oubli.
La rétrospective de ses films que lui avait consacré l’Institut Français était d’ailleurs intitulée « un cinéma hanté ». Car François Caillat explore les figures invisibles qui hantent notre mémoire et transcendent le réel comme autant de milliers de fragments.
Dans son magnifique film “ Une jeunesse amoureuse ”, le réalisateur revisite ses amours de jeunesse, parcourt les lieux de sa cartographie amoureuse, et nous emmène au coeur même de ses souvenirs dans le Paris des années 70. Les images se superposent au récit comme les lettres, les visages et les archives super-8 de ses voyages se mêlent à notre propre mémoire. Une intimité singulière en surimpression d’une mémoire collective.
La grande armée du travail.
Dans Bienvenue à Bataville, François Caillat décrit l’empire de Tomas Bata en le ressuscitant par le biais d’une voix off. Il opte pour un dispositif entre fiction et documentaire mettant en scène des tableaux où les acteurs rejouent le passé de façon artificielle avec des couleurs exagérement fausses. Ce parti pris, s’il peut déranger à première vue, est en fait un coup de génie : dénoncer de l’intérieur l’utopie de Toma Bata. Le récit est entrecoupé d’interviews d’anciens ouvriers, d’images d’archives et sonores et de ces fameuses scènes qui servent davantage à illustrer ce que Bata le créateur a imaginé, qu’à reconstituer une réalité dépassée. Rien ne parait réel tant Bataville est construit comme l’oeuvre d’un seul homme, mégalomane et paternaliste.
Situé en Moselle, Bataville semble tout droit sorti d’un roman de science-fiction dont le slogan serait “le bonheur est obligatoire”. L’homme qui “voulait chausser l’humanité”, voulait aussi imposer sa notion de bonheur à sa “famille” d’ouvriers. Bataville, ce sont donc des pavillons et des habitations pour eux, des complexes sportifs pour les garder en pleine santé, des concerts obligatoires et des médailles de mérite. En somme, Bataville s’érige en exemple de ville-forteresse où les vassaux-ouvriers servent leur seigneur, en échange de quoi ils obtiennent une assurance de bonheur minimal (un toit, un salaire, quelques loisirs). Le tout, loin du monde extérieur comme pour mieux contrôler ses salariés forcément reconnaissants de tous leurs avantages. C’est le principe même de la servitude volontaire et, comme dit le chef du personnel avec conviction : « les gens ont besoin d’être dirigés ». A Bataville, on dirige même leur vie.
Mais quels sont donc les principes fondateurs du bonheur made by Toma Bata ?
Une femme discrète, un homme agréable.
En 1931, Toma Bata s’appuie sur l’exemple de la modernité de Ford pour imaginer sa cité idéale, partant du postulat que pour que chacun travaille efficacement, il doit avoir des droits élémentaires, comme un foyer propre et bien tenu, des loisirs, pratiquer du sport et reconnaître à son patron son sens de la justice. Tout est dès lors pensé pour éviter les révoltes, éloigner les pensées ou les comparaisons avec un autre monde quelques kilomètres plus loin. Bataville est né, ses pelouses trop vertes ont poussé autour des étangs, sa fanfare joue pour distraire et battre le temps et ses maisons se construisent comme autant de petites prisons. Nul besoin de se tourner vers un autre lieu, Bataville vous offre tout ce qu’il vous faut. Il vous suffit de rester un bon ouvrier, de vous fatiguer à la tâche pour être davantage récompensé, recevoir la signature de votre contremaître et vous obtiendrez tout le bonheur que Monsieur Bata a inventé pour vous.
Une école de la vie.
Personne ne se plaint à Bataville, tout le monde est heureux. Il n’y a qu’à les écouter, vous verrez bien que le bonheur est simple. Il y en a qui se plaignent ? Qui évoquent la pénibilité du travail, la perversité paternaliste de Bata ou les profits réalisés ? Coupez le son qu’on ne les entende pas !
François Caillat choisit de censurer ses interviews pour mieux servir la construction d’un système qui s’auto-détruit de l’intérieur. Il a cependant volontairement conservé quelques paroles qui nous rappellent l’humanité des Batavillois derrière leur louange, leur souffrance, leur épuisement, leurs larmes, leur résignation. On pense en ce sens à un autre film sur un monde imaginaire, Disneyland, mon pays natal d’Arnaud des Pallières. Ce dernier, soumis à la censure de Disney, parvint, tout en respectant leur charte, à détourner son Voyage-Voyage (programme d’Arte) et dénoncer la cruauté inhérente à l’artifice de la machine Disney. Il n’eut pas le droit, par exemple, de filmer les personnages de trop près pour ne pas briser la magie, mais lorsqu’il filme Blanche-neige derrière des barreaux ou les larmes des enfants perdus entre leur émotion et leurs peurs, ou encore la solitude d’un vieil homme qui tourne seul dans les tasses d’Alice, le ton est donné. Le pays des rêves ressemble à un cauchemar tant tout est faux, lisse et sans vie.
Bata veut croire que Bataville est une école de la vie pour ses employés/ habitants. Mais de quelle vie parle-t-il ? De celle que lui en grand marionnettiste a conçue ?
Tu n’adoreras qu’un seul Dieu !
Il ne reste rien de Bataville aujourd’hui, les pelouses ont perdu leurs couleurs, les ouvriers leur travail et l’utopie du bonheur a laissé place aux mauvaises herbes.
“ Bienvenue à Bataville ” est aussi une parabole de notre société consumériste où nous sommes finalement tous les marionnettes d’un grand théâtre, où l’avoir finit par éteindre l’être, et si nous avons davantage d’ouverture, de choix et de possibles, qu’en faisons-nous vraiment ? Le film questionne bien au-delà de cette utopie. Si François Caillat fait revivre les fantômes c’est peut être aussi pour nous rappeler qu’ils flottent encore parmi nous.
Article publié sur le site LOULIPO, cliquer ici
Anne-Laure Farges, formée en réalisation documentaire aux Ateliers Varan, a été responsable éditoriale de la plateforme VOD Les Manufactures (Editions Montparnasse). Elle travaille comme conceptrice rédactrice en communication à Loulipo. Elle est également scénariste et réalisatrice.
Contacts et liens : production, diffusion, distribution
BIENVENUE A BATAVILLE (90’)
Supports disponibles : DCP/ Beta num/ DVD/ fichiers
Le film existe en version française ou en version anglaise
Distribution, diffusion du film :
Tempo Films
Contact : tempofilmsprod@gmail.com
Location du film pour séances collectives (secteur culturel) :
Contact : tempofilmsprod@gmail.com
DVD, achat en librairie ou en ligne :
Paris, Librairie Potemkine : cliquer ICI
Acheter sur le site de la librairie : cliquer ICI
Version anglaise (dialogues sous-titrés, voix off anglaise de Michaël Lonsdale) :
Contact : tempofilmsprod@gmail.com
Location et projections publiques en bibliothèques et médiathèques
Images de la culture (CNC)
Dans la presse
Libération
« Bienvenue à Bataville » n’est pas tout à fait un documentaire. C’est plutôt le film qu’on attendait sur la fin du travail en tant que valeur, et qui n’en redeviendra jamais une parce qu’on s’est trop foutu de nous.
(Éric Loret, Libération, 19.11.2008)
L’Humanité
François Caillat nous montre ici, dans des couleurs saturées chaleureuses, un univers concentrationnaire dont les barreaux seraient peints en bleu ciel (…) Nous sommes chez le Demy des Demoiselles de Rochefort, chez le Tati de Playtime, dans Le Prisonnier ou The Truman Show (…) La référence revendiquée par l’auteur n’est autre que Brigadoon, la comédie musicale de Vicente Minelli. Qu’on puisse s’inspirer d’une telle œuvre pour réaliser un documentaire nous enchante (…) Bataville, c’est du Lumière qui aurait été filmé par Méliès.
(Jean Roy, L’Humanité, 19.11.2008)
Les Cahiers du cinéma
Scrutateur habile et attentif du passé, filmeur de la disparition, François Caillat
tente, pour sa première sortie en salle, l’exploration de voies narratives originales.
Au docu attendu, industriel et industrieux, le documentariste substitue la
restitution primesautière d’une utopie paternaliste.
(Thierry Meranger, Les Cahiers du cinéma, décembre 2008)
Il était une fois au cinéma
En nous dressant en creux le portrait d’un patron à la papa (…), le magnifique
film de François Caillat se promène dans ce qui reste de l’empire Bata et interroge
les survivants. Il nous montre alors une sorte de « meilleur des mondes » (…)
Avec sa mise en scène glacée, ses couleurs proprettes, ses entretiens sans effet
s scénographique, sobres et quasiment sociologiques, François Caillat nous livre un
film passionnant pour qui veut comprendre les extrémités du capitalisme revu par le paternalisme.
Prolétaires de tous les pays, allez voir Bataville !
(Max Mejean, Il était une fois au cinéma, novembre 2008)
CRITIKAT
Réflexion ludique mais dérangeante sur la « servitude volontaire », Bienvenue à Bataville porte un regard critique sur le capitalisme paternaliste (…) On a alors l’impression de se plonger dans une banlieue lénifiante de Weeds ou d’American Beauty, quelque part entre AB Productions et Jacques Tati.
(Emmanuel Didier, CRITIKAT, 18.11.2008)
Liaisons sociales magazine
Ce documentaire est un coup de maître : au-delà de l’analyse réussie du paternalisme, il transgresse les codes du genre, mêlant images d’archives, reconstitution façon comédie musicale et humour à la Tati. Un bijou.
(Anne Fairise, Liaisons sociales magazine)
Le Point
François Caillat reconstruit l’utopie de Tomas Bata avec un dispositif astucieux :
une voix off dévolue au démiurge Bata, des lieux à la « Amélie Poulain », des
archives et les témoignages des anciens… la nostalgie fonctionne à plein. Celle
d’un temps avant la crise, les multinationales…
(François-Guillaume Lorrain, Le Point)
www.zerodeconduite.net
Porté une voix-off autoritaire et péremptoire, qui dirige le spectateur là où elle a
envie de le mener, Bienvenue à Bataville est un documentaire comme on n’a pas
l’habitude d’en voir.
(www.zerodeconduite.net)
www.avoir-alire.com
Entre les embardées poétiques (on pense parfois aux Revenants de Robin
Campillo) et l’enquête documentaire scrupuleuse, Bienvenue à Bataville revient
sur une des dernières utopies du monde du travail en France… Cette poésie amère
anime ainsi une oeuvre dont la matière didactique aurait donné ailleurs un
documentaire carré mais sans finesse.
(Baptiste Drake, www.avoir-alire.com)
Sciences Humaines
Le documentaire de François Caillat, dans un style parfois proche de la comédie
anglaise, ausculte cette utopie sociale et réunit les témoignages de ceux qui y
vécurent. Il en résulte un film étrange, presque dérangeant, tant le réalisateur
débusque la servitude volontaire derrière la félicité batavilloise.
(Aurélien Lester, Sciences Humaines)
Dernières Nouvelles d’Alsace
La critique se fait ici de l’intérieur, le système s’auto-dégrade à l’instant qu’il se dévoile : longs travellings mélancoliquement kitsch sur des familles ostensiblement heureuses, des jeunes filles en fleurs et des hommes aux statures de héros prolétaires ; plans fixes fantomatiques, bal des spectres ; reconstitutions au millimètre, et cependant étrangement instables, d’un système comme suspendu dans un espace-temps évanoui. Les déviants, bien sûr, en sont éliminés sans scrupule. On croyait être dans un film de Jacques Tati, on se retrouve chez Georges Orwell : Bataville est la chronique de mutiples servitudes consenties, et avec le sourire. D’ailleurs, est-ce bien un documentaire ? Ou plutôt la fiction rejouée, par ses protagonistes même, d’un fantasme totalitaire qui se donnait, et continue de se donner, des airs de rationalité bonhomme ? Le vrai, c’est que Bataville est ni plus ni moins qu’un film moins qu’un film d’horreur. On s’y fera donc très peur, avec plaisir et pas mal d’humour, en sortie alsacienne-lorraine à partir du 7 mai, avant une distribution dans le reste de la France en septembre prochain.
(Jérôme Mallien, Dernières Nouvelles d’Alsace, 2.05.2008)
Loulipo
BATAVILLE, L’UTOPIE D’UNE AUTARCIE
François Caillat est un cinéaste rare, un documentariste de l’absence et de l’oubli, ou plutôt de l’empreinte que laissent l’absence et l’oubli. La rétrospective de ses films que lui avait consacré l’Institut Français était d’ailleurs intitulée « un cinéma hanté ». Car François Caillat explore les figures invisibles qui hantent notre mémoire et transcendent le réel comme autant de milliers de fragments. Dans son magnifique film (j’y reviendrai bientôt) Une jeunesse amoureuse, le réalisateur revisite ses amours de jeunesse, parcourt les lieux de sa cartographie amoureuse, et nous emmène au coeur même de ses souvenirs dans le Paris des années 70. Les images se superposent au récit comme les lettres, les visages et les archives super 8 de ses voyages se mêlent à notre propre mémoire. Une intimité singulière en surimpression d’une mémoire collective.
La grande armée du travail.
Dans Bienvenue à Bataville, François Caillat décrit l’empire de Tomas Bata en le ressuscitant par le biais d’une voix off. Il opte pour un dispositif entre fiction et documentaire mettant en scène des tableaux où les acteurs rejouent le passé de façon artificielle avec des couleurs exagérément fausses. Ce parti pris, s’il peut déranger à première vue, est en fait un coup de génie : dénoncer de l’intérieur l’utopie de Toma Bata. Le récit est entrecoupé d’interviews d’anciens ouvriers, d’images d’archives et sonores et de ces fameuses scènes qui servent davantage à illustrer ce que Bata le créateur a imaginé, qu’à reconstituer une réalité dépassée. Rien ne paraît réel tant Bataville est construit comme l’oeuvre d’un seul homme, mégalomane et paternaliste.
Situé en Moselle, Bataville semble tout droit sorti d’un roman de science fiction dont le slogan serait « le bonheur est obligatoire ». L’homme qui « voulait chausser l’humanité » voulait aussi imposer sa notion de bonheur à sa « famille » d’ouvriers. Bataville ce sont donc des pavillons et des habitations pour eux, des complexes sportifs pour les garder en pleine santé, des concerts obligatoires et des médailles de mérite. En somme, Bataville s’érige en exemple de ville forteresse où les vassaux-ouvriers servent leur seigneur en échange de quoi ils obtiennent une assurance de bonheur minimal (un toit, un salaire, quelques loisirs). Le tout, loin du monde extérieur comme pour mieux contrôler ses salariés forcément reconnaissants de tous leurs avantages. C’est le principe même de la servitude volontaire et comme dit le chef du personnel avec conviction : « Les gens ont besoin d’être dirigés ». À Bataville, on dirige même leur vie.
Mais quels sont donc les principes fondateurs du bonheur made by Toma Bata?
Une femme discrète, un homme agréable.
En 1931, Toma Bata s’appuie sur l’exemple de la modernité de Ford pour imaginer sa cité idéale, partant du postulat que pour que chacun travaille efficacement, il doit avoir des droits élémentaires, comme un foyer propre et bien tenu, des loisirs, pratiquer du sport et reconnaître à son patron son sens de la justice. Tout est dès lors pensé pour éviter les révoltes, éloigner les pensées ou les comparaisons avec un autre monde quelques kilomètres plus loin. Bataville est né, ses pelouses trop vertes ont poussé autour des étangs, sa fanfare joue pour distraire et battre le temps et ses maisons se construisent comme autant de petites prisons. Nul besoin de se tourner vers un autre lieu, Bataville vous offre tout ce qu’il vous faut. Il vous suffit de rester un bon ouvrier, de vous fatiguer à la tache pour être davantage récompensé, recevoir la signature de votre contremaître et vous obtiendrez tout le bonheur que Monsieur Bata a inventé pour vous.
Une école de la vie.
Personne ne se plaint à Bataville, tout le monde est heureux. Il n’y a qu’à les écouter, vous verrez bien que le bonheur est simple. Il y en a qui se plaignent ? Qui évoquent la pénibilité du travail, la perversité paternaliste de Bata ou les profits réalisés ? Coupez le son qu’on ne les entende pas !
(site Loulipo, 27 janvier 2015)
English / Español / Italiano
Welcome to Bataville:
Tomas Bata, the man whose dream it was to shoe humanity, conducted a daring economic and social experiment in 1932 when he set up a model community around one of his shoe factories in the Lorraine region of France.
…
“Welcome to Bataville”… the story of a short-lived utopia.
Tomas Bata, the man whose dream it was to shoe humanity, conducted a daring economic and social experiment in 1932 when he set up a model community around one of his shoe factories in the Lorraine region of France.
Now, seventy years on, the ruins of this totalitarian paradise still bear testimony to the exuberances and excesses of paternalism.
A tale of imposed happiness…
For the english version of “Bienvenue à Bataville” (“Welcome to Bataville”), ask at: tempofilmsprod@gmail.com
remplissage en cours